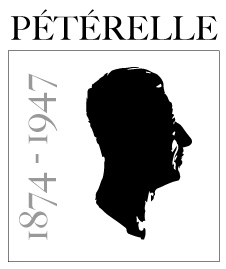1932
VALLON, Fernand, « Pétérelle », Art et Médecine, mai, p. 38-40.
Extrait p.38-40 :
Il a eu des contrats, mais au moment de livrer son tableau, il lui découvrait une pauvreté rédhibitoire et le massacrait. Pourtant des galeries sont parvenues à lui en arracher et, d’apprendre que le marchand avait vendu un Pétérelle dixmille francs, l’artiste a ouvert tout rond celui de ses yeux que lui a laissé la guerre. Par instants, cependant, il a l’air de savoir ce qu’il vaut. Tout à l’heure, il va saisir un de ses sombres dessins sculpturaux. C’est un pastel. Or, autour de cette tête de femme semble rôder je ne sais quel souvenir des petits-maîtres du xviiie. Mais, en admettant qu’il soit de la famille, c’est un étrange parent, trop riche ou trop pauvre à votre gré, excessif en tout cas. C’est un La Tour qui aurait connu Goya, Manet et Carrière, fréquenté Zola, lu Dostoïevski, après avoir essuyé trois révolutions et fait la dernière guerre, dans les millepattes (lisez l’infanterie, puisque c’est ainsi que Pétérelle avec un vaillant sourire, désigne la « reine des batailles »). Il accroche son pastel sur la cimaise encombrée, se recule, cligne de l’oeil et me regarde, inquiet. Car le hasard a voulu que l’oeuvre voisine avec des photographies des voûtes de la Sixtine. Une des vastes figures, si puissamment lasses, de Michel-Ange est couchée sur le « La Tour 1932 ». Celui-ci résiste, néanmoins : il ne plie pas sous le poids formidable. « Ça se tient, dis-je, même parmi ça ! ». Il hausse les épaules, reprend son carton, le jette dans un coin et parle d’autre chose. L’instant d’après, il me le donnera : « Puisqu’il vous plaît ! » insiste-t-il. N’en douterait-il pas qu’il aurait le même geste, je le sens, car il a l’effusion prompte des enthousiastes et la générosité des féconds.
Il rêve : « Faire un tableau, un seul qu’on puisse ne pas rougir de laisser derrière soi ! » Il dit encore : « Les choses doivent être intérieures et non pas extérieures ». C’est tout un programme et c’est tout son art. Saurait-il exprimer quelque chose qui ne soit passé par son coeur, n’ait été mêlé à son sang ?
Il me montre des églises. Car, orphelin à un an, il fut, à sept, recueilli par une soeur de sa mère et la bonne dame était pieuse. Il l’accompagne aux offices et c’est pour le petit peintre une révélation bouleversante. Ce sont les grandes ailes des orgues qui l’éventent et dans le recul des nefs obscures la flamme jaune des cierges qui monte en tremblant vers le paradis des vitraux. Ce sont les vieilles pierres, dont plus tard, sa brosse redira le grain et l’élan, qu’elle sculptera, solide comme un ciseau, dans la profondeur de ses toiles. Et comme, déjà, il a, tel Delacroix, « un orage dans le coeur », tout ce qu’il voit prend une ampleur terrible. Quelques années après, au Louvre, il rencontrera les Espagnols et n’en croira pas ses yeux, tant ils lui restitueront le frisson sacré de son enfance. Aujourd’hui, à 58 ans, il peuple encore de pénitents bruns la pénombre de ses églises, il achemine encore de véhémentes processions dans ses paysages dont le tourment est digne de ses amis de l’Inquisition. Pour exprimer le zèle des âmes, il allume sur le cortège les feux de son ardente couleur et les vermillons, les bleus et les ors crépitent sur les cagoules comme un feu d’artifice. Dans sa Bénédiction, il retrouve les accents d’une piété perdue. Comme au temps des grandes calamités médiévales, le geste lumineux du prêtre s’élève sur la prostration des fidèles. Sévère et pure symphonie à deux notes : le blanc et le noir.
Massifs et nocturnes, les dessins de Pétérelle la chantent enchoeur. Voici le charretier et son cheval qui nous arrivent de front ; telle infante, âpre comme un Goya, noire statue qui s’enfonce dans les gris brouillés, si tendres, et, perdue dans le désert et le silence d’une grande feuille, une étrange petite tête ronde, stridente comme un cri, dure comme un caillou, tragique comme une tête coupée. Et puis, à pleine page, règnent de monumentales faces humaines, dont la fixité a quelque chose de fatal et la matière et la dureté et l’éternité triste du granit.
« Avec quelle maîtrise – souplesse et liberté – maniez-vous le noir et le blanc ! m’écrié-je. Quel incomparable lithographe eussiez-vous fait ! – Ne regrettez rien, répond-il. J’ai fait de la litho, j’en fais encore, mais je ne suis pas incomparable : il y a Daumier, vous savez bien, Daumier… ? Le mieux qu’on puisse dire de mes cailloux, c’est que je me suis efforcé de ne pas les salir inutilement. Car on ne doit pas travailler sur la pierre comme sur le papier ».
L’instant d’après, je suis en présence des Fresques, selon le nom que leur a donné un éditeur intelligent. Elles ont, certes, l’ampleur de la plus belle peinture murale. Entre toutes, j’en ai aimé deux : une femme et un paysage que je vais essayer de vous dire en deux mots.
En vue de lentes collines noires, jonchant le sombre gazon lithographique, ancillaire un peu et plantureuse comme un Renoir, puissante et chaste comme un Michel-Ange, celle-là était étendue. L’ombre et la lumière se disputaient son large dos avec des chances alternées. Il y avait de belles victoires, où, abandonnant les sphères de la croupe devant les blancs de neige, les noirs de velours, reculaient en masse. Avec, parmi les nobles montagnes, la large courbe de son fleuve profond, l’autre avait la majesté d’un paysage biblique. Il était assez vaste pour être le cadre de quelque Création du Monde.
C’est curieux, s’écrie Pétérelle, à quel point vous me rappelez, en ce moment, l’Amateur d’estampes : même attitude penchée, même recueillement, même secrète délectation.
Car il est plein de Daumier. Il parle la même langue, grave, dépouillée, concentrée et concentrique. Les grandes coulées ardentes de Pétérelle font penser à la « boue sanglante » de Daumier. Tous deux, d’ailleurs, ont dans le même enveloppement tendre, le même arrondissement sculptural et, dans l’émotion, la même pudeur. Mais Pétérelle, qui est bien plus peintre, a plus d’éclat. À force d’amour et de travail, il est arrivé à donner à sa peinture une matière inédite. Fondue au creuset de son coeur, elle a les couleurs du grand feu, elle évoque les fusions du métal.
Décidément, j’ai gagné sa confiance, car pour me montrer son « Renoir de cuivre », comme il dit, le voici qui ouvre l’armoire interdite. Admirable toile, un reflet de fournaise l’éclaire encore ! Et comme pour calmer cet embrasement, des bleus, les bleus de Pétérelle, ruissellent, telle une fontaine, des mains au rouge sombre. Mais l’artiste fouille encore son trésor et s’impatiente car il ne trouve pas la peinture qu’il cherche. Il la découvre enfin. « Et celle-là, qu’en dites-vous ? » interroge-t-il. C’est la dernière dont je vous parlerai.
Malgré le cargo qui sombre, là-haut, à la ligne d’horizon, trop près du cadre pour qu’y puissent avoir place l’espoir et la douceur du ciel, malgré la barque de sauvetage, si tragique avec sa cargaison de douleur et de mort, la mer, épaisse et lourde comme le Styx, demeure farouchement déserte. Et le bateau ivre, sans rameurs, spectral, descend en diagonale vers les premiers plans.
Devant ce drame, on pense à Delacroix. Mais il ne suffit pas à Pétérelle d’avoir, comme le grand peintre, un orage dans le coeur, il connaît encore la sombre magnificence du « prince persan ». N’aurait-il pas, d’ailleurs, un peu de son âme véhémente, son nom l’eut prédestiné : ce n’est pas en vain qu’on s’appelle si romantiquement Pétérelle, comme l’oiseau des tempêtes.